D’une Chine à l’autre : l’Inde entre tensions et révisions
Programme Taïwan sur la sécurité et la diplomatie
Gilles Boquérat,
5 juillet 2021
Un an après l’affrontement entre soldats chinois et indiens à Galwan au Ladakh le 15 juin 2020, qui coûta la vie à vingt de ces derniers (et officiellement à quatre membres de l’Armée Populaire de Libération), les forces déployées sur la frontière par les deux pays restent en état d’alerte, rappelant que le contentieux frontalier n’a rien perdu de sa capacité à peser négativement sur les relations sino-indiennes, presque quarante ans après le conflit qui avait opposé les deux pays à l’automne 1962.
Pour New Delhi, les troupes chinoises se sont aventurées au Ladakh au-delà de la ligne de contrôle effectif (Line of Actual Control, LAC), alors même que deux récents sommets informels entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping (Wuhan, avril 2018, et Mahabalipuram, octobre 2019), avaient été l’occasion de réaffirmer la nécessité de maintenir la paix et la tranquillité sur la frontière himalayenneAucun Premier ministre indien, avant Modi, n’a réalisé autant de visites officielles en Chine (cinq). La Chine avait même accueilli Narendra Modi à quatre reprises lorsque celui-ci était à la tête de l’Etat du Gujarat (2001-2014) et persona non grata dans nombre de pays occidentaux, où il était ostracisé pour son laxisme lors des émeutes antimusulmanes de 2002.. On pouvait même lire dans le rapport annuel du ministère indien de la Défense que « la stabilité dans les zones frontalières entre l'Inde et la Chine s'est améliorée et s'est maintenue » sur fond de nouvel élan dans les échanges en matière de défenseAnnual report 2018-19, Ministry of Defense, Government of India, pp. 4-5. Ainsi, en décembre 2019, s’étaient déroulés au Meghalaya les huitièmes exercices conjoints « Hand in Hand » associant soldats indiens et un contingent chinois venant du commandement militaire du Tibet.. L’amélioration observée faisait référence aux incidents survenus au cours des années précédentes aussi bien dans la partie occidentale (Depsang en 2013, Chumar en 2014) que dans la partie orientale (Doklam en 2017). Plusieurs accords bilatéraux auraient dû a priori prévenir les risques d’accrochages liés à une interprétation parfois divergente de la LAC. La dernière escarmouche faisant un nombre important de victimes remontait d’ailleurs à 1967, lorsque 88 soldats indiens furent tués au col de Nathu, à la frontière entre le Sikkim, alors protectorat indien, et la ChineEn octobre 1975, année du rattachement du Sikkim à l’Inde, quatre soldats indiens furent tués lorsqu’une patrouille des Assam rifles fut embusquée en Arunachal Pradesh par un peloton chinois..
Si les relations bilatérales ont, depuis soixante-dix ans, souvent laissé place à la défiance, les événements de l’année écoulée ont marqué un nouveau palier dans l’acrimonie. Ils offrent aussi l’occasion d’une réévaluation par l’Inde de la relation avec Taïwan.
La nature du contentieux frontalier
Le différend entre les deux pays sur le tracé de la frontière himalayenne porte essentiellement sur deux secteurs : à l’ouest sur l’Aksai Chin, et à l’est sur l’Etat indien de l’Arunachal Pradesh connu sous l’acronyme NEFA (North-East Frontier Agency) jusqu’en 1972Un différend mineur existe aussi dans le secteur central de la frontière, à l’ouest du Népal.. Le contentieux est indissociable de l’invasion du Tibet par la jeune République populaire de Chine (RPC) fin 1950, qui mit l’Inde et la Chine en contact direct. Selon la cartographie officielle indienne, ces deux territoires appartiennent à l’Inde en vertu, notamment, dans le cas de l’Aksai Chin, d’une frontière « naturelle, traditionnelle et coutumière » confirmée notamment par le traité de 1842 entre le Tibet et le Ladakh. Pour autant, il n’y eut jamais de démarcation au sol. Quant au secteur oriental, l’Inde invoque surtout la convention de Simla de 1914 signée entre les gouvernements britannique et tibétain et au cours de laquelle fut grossièrement tracée la ligne Mc Mahon suivant la ligne de crête himalayenneSur les arguments développés par les Indiens et les Chinois, voir Report of the Officials of the Governments of India and the People’s Republic of China on the Boundary Question, Ministry of External Affairs, Government of India, 1961.. La Chine communiste ne s’est pas considérée tenue par des accords passés par les autorités tibétaines ou relevant de la période coloniale en Inde. Si l’Aksai Chin est de fait sous le contrôle des Chinois depuis les années 1950, durant lesquelles ils construisirent une route le traversant et reliant le Tibet au Xinjiang, l’Inde est en possession, à l’est, de ce que Pékin préfère nommer « Tibet du Sud », en revendiquant une démarcation passant au pied des contreforts himalayens et en bordure de la vallée du Brahmapoutre.
Par le passé, les Chinois se sont dit prêts à accepter la ligne Mac Mahon en échange de la reconnaissance par l’Inde de leurs prétentions territoriales sur l’Aksai Chin. C’est la base de l’accord que proposa Zhou Enlai à Nehru en 1960. Le Premier ministre indien refusa, décidant d’une imprudente – au regard de l’impréparation militaire – « forward policy » consistant à manifester sur les territoires contestés une présence militaire ; ce qui fut un facteur contributif au déclenchement de la guerre à l’automne 1962. Si l’Inde fut alors défaite, Pékin se contenta surtout de consolider ses positions sur le haut plateau de l’Aksai Chin. Une LAC sépare depuis les deux pays sur 3 500 kilomètres, dont 1 600 kilomètres dans le seul secteur occidental. Le problème frontalier tient aujourd’hui essentiellement à des désaccords ponctuels sur le tracé de la LAC, jamais formellement agréé sur toute sa longueur par les deux parties. Aussi, pour prévenir toute confrontation, différents accords ont prévu l’adoption de mesures de confiance dans l’attente d’un règlement politique.
[...]
Afin de lire cette version, merci de télécharger le fichier ci-dessous.
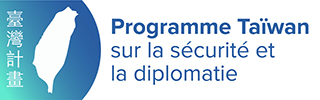

D’une Chine à l’autre : l’Inde entre tensions et révisions
Gilles Boquérat, 5 juillet 2021